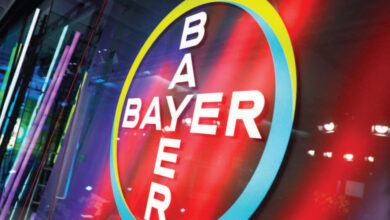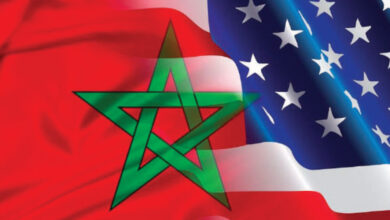Marché de l’emploi : la prochaine décennie sera décisive

Le Maroc fait face à un paradoxe : une économie en mutation rapide, mais un marché de l’emploi miné par la précarité, les inégalités et l’informalité. Un rapport du Centre africain pour les études stratégiques et la digitalisation (CAESD), publié ce mois, sonne l’alarme. Il appelle à une transformation profonde, entre révolution éducative, nouvelles protections sociales et virage écologique assumé. Le pays a dix ans pour agir.
Alors que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030, son marché de l’emploi traverse une période charnière. Un rapport stratégique intitulé «Entre fragilité structurelle et opportunités d’avenir» dresse un état des lieux sans complaisance, entre constats alarmants et lueurs d’espoir. À travers une analyse poussée, ce document publié ce mois par le Centre africain pour les études stratégiques et la digitalisation (CAESD), éclaire les faiblesses systémiques de l’économie marocaine et propose des pistes ambitieuses pour un redressement durable.
Une économie sur le fil du rasoir
Malgré certaines réussites apparentes, telles que l’essor de l’industrie automobile et le boom du tourisme, le modèle économique marocain reste fondamentalement vulnérable. Le rapport évoque «une dépendance excessive à l’Europe et des paris conjoncturels» qui menacent la stabilité de l’emploi à moyen terme.
Ce constat est illustré par une statistique frappante : plus de 80% des exportations automobiles marocaines sont destinées à la France et à l’Espagne, exposant le pays à tout changement de politique commerciale ou de demande sur ces marchés. La situation est encore plus critique pour le secteur des centres d’appel. Près de 90.000 jeunes y sont employés, dont 80% pour le marché français. Mais la nouvelle législation en France restreignant le démarchage téléphonique, prévue pour 2026, risque de «menacer directement des dizaines de milliers d’emplois».
Le rapport met aussi en garde contre l’«illusion de durabilité» de certains moteurs de croissance, notamment dans les services et la construction. Ainsi, les chantiers massifs liés à la Coupe du monde 2030 pourraient créer une «bulle d’emplois temporaire» qui éclaterait après l’événement, à moins d’une stratégie claire de reconversion.
Indicateurs au rouge vif
Le diagnostic établi dans le rapport est sévère : un chômage structurel de 12,8% au niveau national, qui grimpe à 37% chez les jeunes et à 20% chez les femmes. Le taux d’activité économique reste sous la barre des 43%, avec une participation féminine inférieure à 18%. Le travail informel domine, absorbant près des deux tiers de la main-d’œuvre, sans protection sociale ni droits fondamentaux.
Le texte dénonce une situation où «1,25 million de personnes sont en sous-emploi ou dans des formes de travail non désirées». Les inégalités géographiques aggravent encore le tableau : la concentration des emplois dans les zones côtières creuse l’écart avec les régions de l’intérieur, alimentant un exode rural continu et une pression croissante sur les grandes villes.
Une double vague de transformation imminente
Deux révolutions secouent déjà le monde du travail et le Maroc n’y échappera pas. La première est technologique : l’intelligence artificielle, l’automatisation et les robots menacent les emplois routiniers, tout en créant une forte demande pour des compétences nouvelles.
«L’IA devient un collègue de travail», écrit le rapport, appelant à une refonte des systèmes éducatifs et à l’instauration de «droits sociaux portables» adaptés à des carrières fragmentées.
La seconde transformation est écologique. Le changement climatique impacte directement les secteurs clés comme l’agriculture et le tourisme côtier. Cependant, il ouvre aussi la voie à «un potentiel de création de 500.000 emplois de qualité à long terme» dans les énergies renouvelables, le recyclage, ou encore le transport durable. À condition d’adopter un «modèle d’économie verte juste et inclusif».
Un nouveau contrat social à inventer
La fragilité du marché de l’emploi appelle à une redéfinition des relations professionnelles. Le modèle du «travail à vie» laisse place à des formes plus souples : freelancing, travail à la mission, gig economy. Mais cette flexibilité s’accompagne de précarité accrue. Le rapport propose ainsi de «réinventer les protections sociales, indépendamment de la nature du contrat de travail».
Du côté des syndicats, la situation est tout aussi critique. Moins de 3% des travailleurs y sont affiliés. Pour redevenir pertinents, ils doivent s’adapter à l’économie numérique : représenter les freelances, défendre les droits numériques, participer à la gouvernance algorithmique. Le rapport plaide pour une mutation vers des «syndicats 4.0», plus inclusifs, proactifs et ancrés dans les réalités contemporaines.
Trois horizons pour l’action
Face à ces défis, le document propose une stratégie en trois temps. À court terme, il faut «diversifier les marchés vers l’Afrique et les Amériques» et créer un fonds de reconversion pour les travailleurs des centres d’appel. À moyen terme, il est impératif d’«engager une révolution de la formation professionnelle» et de «légaliser les nouvelles formes de travail avec des droits adaptés».
Enfin, à long terme, le rapport appelle à des expérimentations audacieuses : «un revenu de base universel, une semaine de travail de 4 jours, et un système national d’apprentissage tout au long de la vie». Ces propositions visent à «bâtir une résilience structurelle, sociale et productive».
Prospectives 2030-2050
Trois scénarios se dessinent, selon le rapport. Le scénario optimiste combine transition verte, numérisation maîtrisée et réforme éducative. Dans celui-ci, le Maroc réussit à intégrer pleinement la transition écologique, à numériser son économie et à transformer son système éducatif. Grâce à un pilotage stratégique de la formation et de l’innovation, le pays devient une plateforme régionale de services numériques et d’industrie verte.
«Ce scénario pourrait créer plus d’un million d’emplois qualifiés à l’horizon 2040» dans les secteurs des énergies renouvelables, du numérique, de la santé, et de l’économie circulaire.
Le scénario de crise, quant à lui, envisage une poursuite de la dépendance à l’Europe et une montée du chômage après 2030. Les chocs externes (ralentissement en Europe, dérèglement climatique, instabilité régionale) s’ajoutent à un manque d’adaptation interne. L’économie informelle s’étend, les classes moyennes déclinent, et l’émigration devient un recours massif.
«La transition ratée pourrait déboucher sur une vague de chômage historique après 2030», alertent les auteurs.
Le scénario médian suppose pour sa part des avancées partielles, mais insuffisantes pour briser la fragilité structurelle. Ici, les réformes structurelles avancent trop lentement, freinées par des blocages institutionnels et sociaux. Le Maroc parvient à limiter les dégâts économiques mais reste prisonnier d’un modèle fragile, avec une croissance faible, un chômage élevé, et une dépendance persistante aux marchés européens. Le risque de tensions sociales demeure élevé, notamment dans les zones rurales ou marginalisées. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des mises en garde stratégiques : «Le Maroc joue son avenir dans les dix prochaines années», est-il souligné.
Mutations proposées
Le rapport recommande d’explorer des mutations ambitieuses telles que le revenu de base universel et la réduction du temps de travail. Le revenu de base serait «une sécurité ultime dans un monde où le travail devient instable». Il pourrait être testé auprès de jeunes ou de travailleurs affectés par l’automatisation, et constituerait un filet de sécurité pour favoriser la prise de risque, la reconversion ou l’activité bénévole.
Objectif : «garantir un minimum vital stable pour encourager la prise de risque, la formation continue, ou l’activité associative». À long terme, il pourrait devenir un levier d’inclusion pour ceux que le marché du travail laisse de côté. Des expériences pilotes dans des pays comme la Finlande ou le Kenya ont montré que les bénéficiaires «ne se désengagent pas du travail, mais investissent davantage dans leur projet de vie». Quant à la semaine de travail de 4 jours, elle vise à «partager les gains de productivité issus de l’automatisation tout en améliorant la qualité de vie».
Des pays comme l’Islande et le Japon en ont expérimenté les bénéfices sur la santé mentale et la performance. Elle s’appuie sur l’idée que l’automatisation et les gains d’efficacité doivent profiter à tous. Le rapport insiste sur les bénéfices : «moins de stress, plus de temps pour la famille, et un regain de motivation». Au Maroc, cela nécessiterait une réforme du Code du travail, mais pourrait commencer par des accords volontaires dans certains secteurs (tech, services, éducation).
Enfin, face à l’obsolescence rapide des savoirs, le rapport propose la création d’une «plateforme nationale de formation continue», accessible à tous. Elle comprendrait un compte personnel de formation crédité chaque année, des modules courts et certifiés accessibles en ligne, une reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE) et un accompagnement individualisé. Ce système «permettrait à chacun de se former tout au long de sa vie, quel que soit son âge, son emploi ou son niveau initial». Il est vu comme une condition essentielle pour garantir l’adaptabilité de la main-d’œuvre face aux mutations du marché.
Leçons internationales pour le Maroc
Le rapport met en lumière plusieurs modèles internationaux comme sources d’inspiration, sans pour autant les ériger en recettes toutes faites. Il s’agit d’en tirer des principes adaptables au contexte marocain, en tenant compte des contraintes budgétaires, institutionnelles et sociales. Le Danemark illustre ce que le rapport appelle la «flexisécurité».
Ce système repose sur un équilibre subtil : d’un côté, une grande flexibilité pour les employeurs, qui peuvent ajuster rapidement leurs effectifs ; de l’autre, une sécurité renforcée pour les travailleurs grâce à des indemnités de chômage généreuses et un accès obligatoire à la formation continue. Cette approche, qui repose sur la confiance et l’investissement public, pourrait inspirer le Maroc, notamment pour les jeunes en reconversion ou les métiers menacés par l’automatisation. En Allemagne, le système d’apprentissage dual est une pièce maîtresse de l’insertion professionnelle.
Les jeunes alternent entre entreprise et formation théorique, ce qui limite le décalage entre compétences acquises et besoins du marché. Le rapport recommande de s’en inspirer en créant des «conseils régionaux mixtes» entre entreprises et établissements de formation, pour mieux aligner les cursus et favoriser l’employabilité dès la sortie de l’école.
Du côté de l’Asie, Singapour apparaît comme un modèle de gestion proactive des talents. L’État y investit dans l’éducation technologique, l’apprentissage de l’anglais comme langue de travail, et la reconversion continue des actifs. Chaque citoyen dispose d’un crédit formation à utiliser tout au long de sa vie. Le Maroc, souligne le rapport, pourrait créer un mécanisme similaire : «un crédit formation citoyen, cumulable, transférable, et utilisable aussi bien par les salariés que les indépendants».
Enfin, les Pays-Bas offrent un exemple intéressant de travail à temps partiel choisi, notamment chez les femmes. Plus de 40% des actifs y exercent leur activité à temps réduit, sans perdre en droits sociaux ni en reconnaissance professionnelle. Le rapport y voit une piste pour «reconnaître et protéger les formes d’emploi hybrides et choisies» : temps partiel, freelancing, portage salarial. Une réforme qui pourrait favoriser l’inclusion sans engendrer de précarité.
Ces expériences montrent que réformer le travail n’est pas un sacrifice, mais une opportunité. Une modernisation sociale réussie s’appuie sur une gouvernance agile, un dialogue social étendu et une volonté politique forte. Adapter ces modèles au Maroc implique de construire des passerelles entre le public et le privé, entre les générations, et entre les régions.
H.K. / Les Inspirations ÉCO